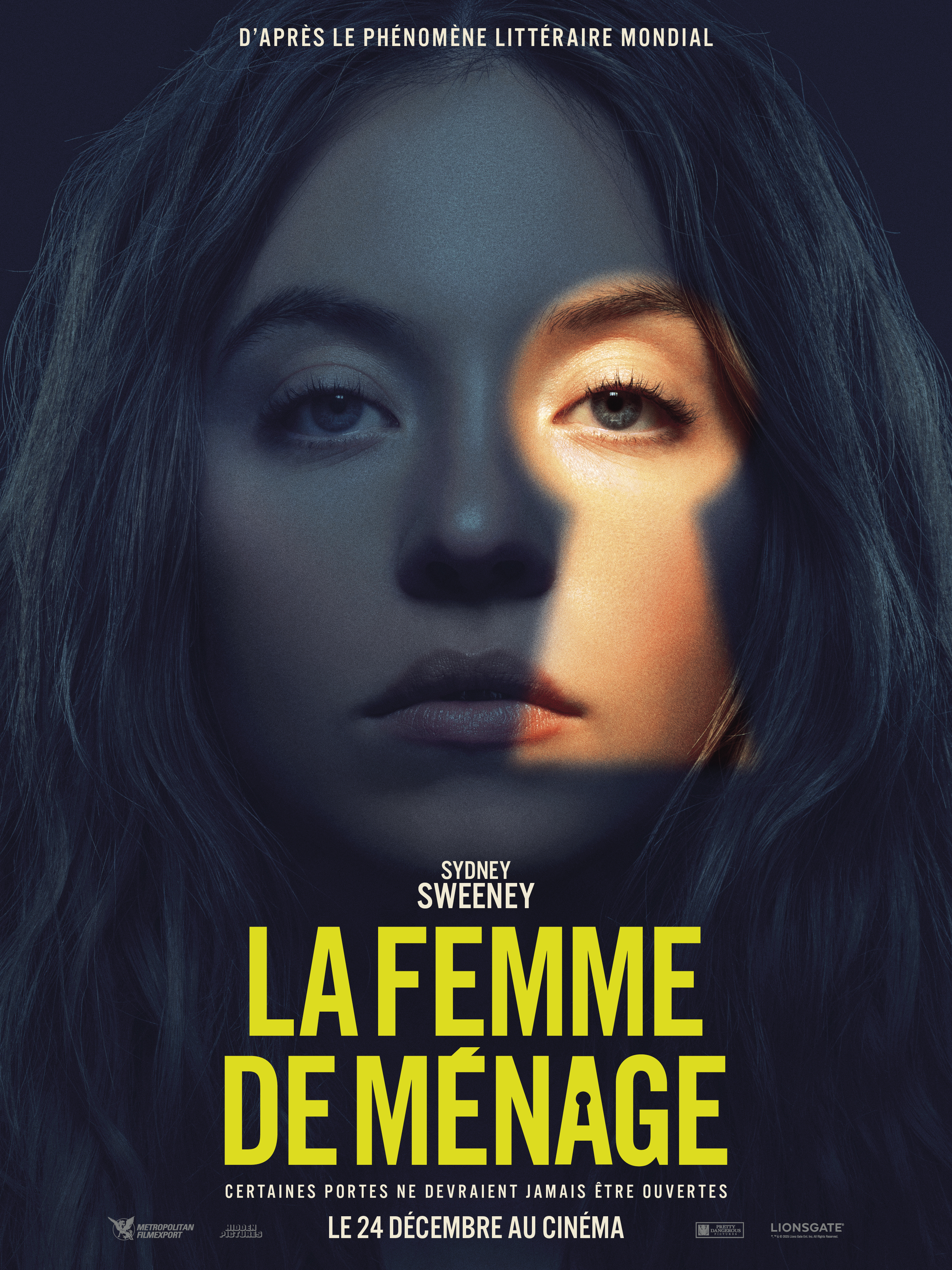« Tel un phœnix, une nouvelle éolienne renaît des cendres de la mort d’une autre. »
L’essor de l’industrie de l’éolien soulève de nombreuses interrogations sur le devenir des éoliennes en fin de vie. Des milliers d’entre elles seront démantelées dans les décennies à venir, et la question de « l’après » est désormais centrale pour les décideurs et les experts. Après une mise en service de 25 ans en moyenne, comment ces grands oiseaux blancs peuvent-ils rendre à la terre ce qu’ils ont emprunté ? Que faire des composants alors que l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) projette que le démantèlement des éoliennes obsolètes pourrait générer entre 3 000 et 15 000 tonnes de matériaux composites par an dès 2025 ? Alors que la capacité de production française d’énergie éolienne terrestre dépassait les 21,39 GW fin juin 2023, plaçant la France au 4e rang des producteurs d’énergie éolien européens, et que le pays approche de son objectif de produire 40 % d’électricité à partir d’énergies vertes, un autre défi se précise : atteindre la neutralité carbone. Pour s’aligner sur l’objectif zéro déchet, les spécialistes de l’éolien explorent des méthodes de recyclage et de valorisation des matériaux afin de réduire l’empreinte environnementale de l’industrie. En France, où plus de 90 % de la masse d’une éolienne est recyclable, les législations nationales et européennes prônent l’adoption d’une économie circulaire dans le secteur de l’éolien pour atteindre le 100 % recyclable. Le Groupe Eurowatt, producteur indépendant d’énergies renouvelables, a rejoint la course au recyclage en adoptant une politique de repowering (renouvellement) de ses parcs éoliens. Sa philosophie, en quelques mots : revaloriser au maximum ce qui peut être réutilisé. S’inscrire dans la durée et l’acceptation locale. Sa stratégie vise à offrir une seconde vie à ses éoliennes, âgées en moyenne de 18 ans. Jean-Philippe Auplat, Gestionnaire d’Actifs chez Eurowatt, nous explique cette notion de renouvellement :
« Si nos machines [les éoliennes] sont en état de fonctionnement, on les laisse en marche. Par contre, quand on voit qu’il peut y avoir un risque technique, ou que la technologie est dépassée, c’est là qu’on envisage de faire du repowering et qu’on les démantèle. 90 % de l’éolienne est recyclée ou revalorisée. On fait alors fondre les aciers et les métaux pour les recouler et on fait de la résine des polymères. On recycle au maximum pour revaloriser, c’est-à-dire qu’on peut estimer financièrement la revalorisation des composants qui peuvent fonctionner et les revendre à des confrères qui ont des modèles inférieurs de turbines […] c’est une économie circulaire. »
L’économie circulaire de l’éolien, on en entend souvent parler et la philosophie du Groupe Eurowatt la résume à merveille : « la machine doit honorer sa fonction ». On va ensuite la revaloriser pour qu’elle accède à une seconde vie. Ainsi, tel un phœnix, une nouvelle éolienne renaît des cendres de la mort d’une autre.
Le démantèlement et le recyclage des éoliennes : une obligation normative
Quand on parle de démantèlement, de quoi s’agit-il ? Tout simplement d’une construction inversée : on va retirer dans l’ordre les pales, le rotor, le torquage, le transformateur, les organes électroniques et les câbles. Pour revaloriser ces matériaux, le démantèlement est la première étape d’un processus de recyclage rigoureusement encadré. En France, cette démarche s’illustre par des législations et réglementations ambitieuses, notamment à travers la publication de l’arrêté du 22 juin 2020 imposant la réutilisation et le recyclage de 95 % de la masse totale des éoliennes d’ici le 1er janvier 2024. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en date du 10 février 2020, qui prévoit l’utilisation des pales d’éoliennes entièrement recyclables d’ici 2040. L’article L. 553-3 du Code de l’environnement renforce ces mesures en exigeant des promoteurs d’approvisionner en garantie la construction d’un parc éolien à hauteur de 50 000 euros par éolienne, ainsi que sa remise en en état après démantèlement. Cette législation s’applique aussi bien aux grands producteurs d’énergie qu’aux propriétaires d’éoliennes domestiques, puisque nous sommes tous égaux devant la loi. Dans la continuité de ces mesures, le secteur européen de l’éolien a interdit la mise en décharge des pales d’éoliennes démantelées, conformément à la directive 2009/28/CE sur l'énergie renouvelable incitant les Etats membres à prendre en compte les impacts environnementaux de ces installations. La directive-cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 prescrit également un traitement méthodique des déchets après démantèlement. Ce solide cadre normatif vise à faire entrer l’économie circulaire dans les pratiques, pour minimiser l’impact environnemental des éoliennes et répondre au défi du zéro déchet.
Objectif zéro déchet : le défi du recyclage des pales d’éoliennes
Nos sociétés s’apprêtent à gérer dans un avenir proche 200 000 tonnes de pales d’éoliennes par an. Ces dernières années, elles étaient incinérées ou enfouies dans le désert, rependant dans la terre et l’air des composés organiques volatils, soit un amas de substances chimiques. Désormais, la priorité est donnée au recyclage ! Contrairement à d’autres composants, les matériaux des pales ne se prêtent pas au recyclage conventionnel : elles sont massives, composées de matériaux composites solides (carbone et fibre de verre), peuvent atteindre jusqu’à 100 mètres de long et peser plusieurs tonnes. Pour les recycler, quatre techniques sont utilisées : la gazéification, le broyage, la pyrolyse et la solvolyse. La pyrolyse expose la pale à la chaleur dans un environnement pauvre en oxygène pour la faire fondre et extraire une matière première utilisée pour concevoir de nouveaux matériaux (coques de navires, carrosseries automobiles...). La solvolyse, technique plus prometteuse, permet d’extraire des matériaux intacts et décomposer la pale par l’emploi de solvants chimiques. Il s’agit de la meilleure des techniques, à condition qu’elle soit maîtrisée. Ces procédés sont encore en développement, mais certaines innovations, telles que les pales écoresponsables en résine thermoplastique, présentent un réel potentiel : « Il fallait oser sortir des standards. Il y a [dans cette création ] l’audace de l’innovation et de la recherche. » Cette résine est plus facilement recyclable que la thermodurcissable, bien que sa réutilisation peut fragiliser ses propriétés, la rendant moins adaptée à la production d’autres éoliennes. Il revient alors aux scientifiques de faire preuve de créativité : des chercheurs américains à l’imagination débordante ont exploré d’autres solutions et ont imaginé transformer la résine en… gélatine pour bonbons !
« La résine est d’origine naturelle, ça fait sens de l’utiliser pour des bonbons […] quand vous prenez de l’argile pour la façonner, pour qu’elle soit plastique et aller vite dans son cycle de séchage, vous pouvez ajouter du sirop de glucose. »
Bien que très créatifs, ces chercheurs américains ne sont pas les seuls à innover : par exemple, l’entreprise GP Reblade fabrique du mobilier urbain à partir d’anciennes pales d’éoliennes, tandis qu’à Rotterdam, des architectes ont transformé ces matériaux en une aire de jeu pour enfants !
Le recyclage des fondations et la valorisation des matériaux : une approche éco-responsable
Le béton, pierre angulaire des fondations et de la base des mâts, est entièrement recyclable. Habituellement concassé, il trouve une seconde vie dans la création de nouvelles éoliennes, chaussées, comblements, granulat ou encore remblai. Toutefois, l’empreinte écologique de ce matériau reste conséquente : la quantité de béton nécessaire pour réaliser les fondations d’une éolienne avoisine les 1100 tonnes ! Face à ce constat, des fabricants privilégient désormais l’éco-conception pour réduire l’empreinte environnementale dès la conception de l’éolienne. Plusieurs pays sont dans la course à l’innovation : la Suède avec Modvion, une société qui va lancer des mâts d’éolienne entièrement en bois, la France avec InnoVent et ses mâts hybrides mêlant bois et acier (installés au parc éolien Essey-les-Ponts), sans oublier l’Allemagne avec Voodin Blades Technology qui s’apprête à commercialiser des pales d’éoliennes à base de bois stratifié (LVL) faciles à démonter. Le bois est une composante renouvelable respectueuse de l’environnement : légère, résistante, carboneutre, elle facilitera le recyclage en fin de vie et réduira les émissions de CO2.
Récupération des terres rares des aimants : un enjeu géopolitique pour retrouver notre indépendance énergétique
Le cœur des éoliennes abrite des aimants permanents fabriqués à partir de terres rares – dysprosium, néodyme, praséodyme, terbium –, des composants très prisés sur le marché des technologies vertes pour leur force magnétique. Les plus gros consommateurs de terres rares sont à l’heure actuelle les disques durs. L’extraction minière de ces minéraux est onéreuse, énergivore, et riche en produits chimiques et ressources hydrauliques. Le monopole de ces ressources en tension est aujourd’hui détenu par la Chine et la Birmanie et il reste difficile de se soustraire totalement à cette influence sans risquer un embargo. C’est la raison pour laquelle beaucoup de producteurs d’électricité sont tributaires de la géopolitique. Par exemple, avec la guerre en Ukraine, les coûts de fonctionnement du Groupe Eurowatt ont augmenté de 30 %. Des alternatives sont depuis recherchées pour retrouver notre souveraineté énergétique, avec le recyclage des aimants qui permettrait d’en produire d’autres pour nos éoliennes ou disques durs, sans dépendre des gros exploitants. Des batteries au sodium-ion se développent également comme une alternative écologique fiable au lithium-ion : durables, rapides à recharger, 20 % à 30% moins chères, car le sodium est une ressource abondante et facile à extraire. Des recherches sont même menées pour réduire la taille voire supprimer la teneur en terre rares des générateurs à aimant des éoliennes.
L’avenir des éoliennes en fin de vie se dessine aujourd’hui avec clarté. La France s’aligne sur l’élan européen dans la course à l’indépendance énergétique et la neutralité carbone. Ces géants de l’air ne se contentent plus de tourner leurs pales en direction du vent, mais vers un avenir plus vert. De nombreux pays ont rejoint le mouvement, développant des techniques innovantes pour créer des éoliennes 100 % recyclables. Les Etats-Unis ont par exemple initié le « prix du recyclage des matériaux des éoliennes » pour encourager leurs chercheurs à se dépasser pour trouver des solutions durables. Il s’agit plutôt d’une aubaine pour la France. En collaborant avec ses voisins innovants, notre pays peut s’ouvrir aux nouveautés scientifiques pour améliorer son arsenal technologique. L’engagement de la France et de ses partenaires européens pour donner une seconde vie aux éoliennes envoie un signal fort aux sociétés mondiales : la durabilité n’est pas une limite, mais bien un horizon des possibles. Le secteur de l’éolien ne connaît pas de frontières. Le croisement des expertises et notre ambition commune pour une économie circulaire de l’éolien nous rapproche de nos objectifs. Aujourd’hui nous sommes témoins d’une prise de conscience mondiale, une volonté collective d’agir de manière responsable, et cela est rassurant pour l’avenir de notre planète, « car celui qui n’y prête plus attention et ne sait plus qu’il habite un navire (la Terre) […] verra bientôt sourdre la mer dont la vague lavera ses jeux imbéciles. » (Antoine-Saint Exupéry – Citadelle, 1948).
Une dernière question se pose : l’éolien est-il la seule source d’énergie verte viable ? Comment se dessine concrètement l’avenir de l’éolien en France ? « Pas de vent, pas d’énergie. Les sites de vent sont toujours au même endroit, de nombreux confrères construisent dans les mêmes lieux, donc il y a une saturation des espaces. Le tout éolien n’est pas une solution. Le mix énergétique l’est. » Il s’agit peut-être de la solution pour faire figurer la France parmi les fleurons mondiaux de l’énergie verte. Peut-être que l’heure est enfin à l’hybridation des énergies.


 FR
FR